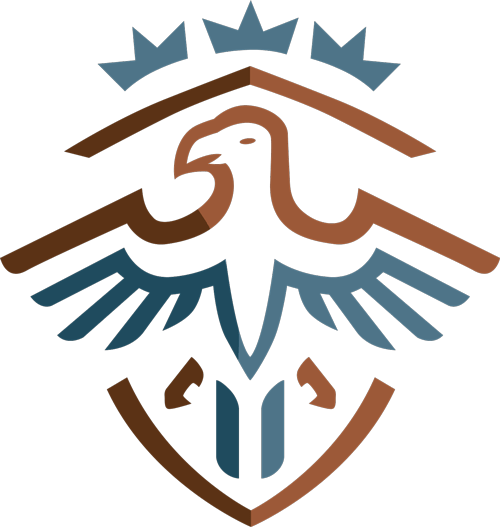22 juin 1940 : Déroute de l’armée française -Bombardement de Bressuire – Entrée des Allemands dans la ville.
23 juin 1940 : Les Bressuirais, atterrés, constatent la mutilation des vitraux de l’église.
« Dans la matinée du 22 juin 1940, mon père m’emmena voir les soldats qui campaient sur la place Saint Jacques, à deux pas de notre maison. J’étais très intéressée, car dans mon livre de lecture, il y avait un texte qui s’intitulait « Le Bivouac ». Au premier abord, je ne fus pas déçue : certains soldats se rasaient, d’autres faisaient reluire leurs chaussures. Je fus cependant intriguée par un jeune soldat assis sur une caisse et qui manipulait des boutons qui étaient sur d’autres caisses noires. Mon père me dit que c’était la radio. J’en fus étonnée, car cela ne ressemblait pas du tout au poste de radio que nous avions chez nous. À part les boutons.
Un gradé, superbe dans son uniforme, et qui avait de magnifiques bottes qui lui montaient jusqu’aux genoux, s’approcha et interrogea le jeune radio. « Toujours rien » lui répondit-il. L’officier se tourna vers mon père et lui dit : « Les salauds, ils ont tous foutu le camp ! » Puis il ajouta : « Vous avez de la famille, alors partez n’importe où en campagne, mais ne restez pas en ville. Il va y avoir des combats de rues cet après-midi ». « Mais, dit mon père, les Allemands n’ont pas passé la Loire ! » C’est en colère que l’autre lui répondit : « Ils sont entrés dans Thouars et se dirigent vers Bressuire où ils vont arriver dans peu de temps. » Mon père était sidéré. « Mais Bressuire est ville ouverte ? » « Vous voulez peut-être que tous ceux-là (il montrait les soldats) soient massacrés ou faits prisonniers ? Je vous le redis, partez ».
À la maison, il y eut un conseil de famille et il fut décidé de déjeuner de bonne heure et d’aller se réfugier dans une ferme dont nous connaissions les habitants. Pendant le repas, un drôle de bruit attira mon attention. Je questionnai mes parents, mais ils ne me répondirent pas. Avant de partir, maman me demanda de l’aider à ramasser le linge qui était à sécher au jardin. Notre jardin avait une porte qui donnait sur la route de Boismé (présentement, rue Roger Salengro ). C’était de cette rue que venait le bruit qui m’intriguait. Maman ouvrit la porte. Ce que je vis me cloua sur place. Ce bruit, c’était des centaines de godillots que traînaient les soldats sur les cailloux de la route qui n’était pas goudronnée à l’époque. Ce n’était pas les soldats proprets que j’avais vus une heure plus tôt. Sales, poussiéreux, pas rasés, débraillés, vestes ouvertes sur des chemises mal boutonnées, c’était une « armée en déroute ». Certains n’avaient plus de lacets à leurs chaussures, d’autres avaient enlevé leur bandes molletières, probablement parce que leurs pieds et leurs jambes étaient gonflés par la chaleur et les kilomètres qu’ils avaient dus parcourir. Je ne m’étais jamais demandée comment étaient les pantalons sous les bandes qui enserraient leurs mollets. En fait, les pantalons étaient plus courts que les pantalons ordinaires et étaient fendus sur le côté, de sorte que les caleçons longs les dépassaient largement. Ce qui me choqua, et en même temps m’apitoya. Ils avaient l’air d’être si épuisés. Plusieurs nous demandèrent à boire en tendant leurs quarts. Nous avons distribué de l’eau. Mais maman ne put s’empêcher de leur faire des reproches. Pourquoi ne résistaient-ils pas face aux Allemands ? On lui répondit que s’ils avaient encore leurs fusils, ils y avait longtemps qu’ils n’avaient plus de munitions. Autrement, ils se seraient fait un plaisir d’abattre cet avion qui les suivait depuis longtemps. En effet, un avion, dont la cocarde vert-blanc-rouge laissait à penser qu’il s’agissait d’un italien, tournoyait à très basse altitude. La colonne s’éloigna, mais une autre arrivait. Maman ferma la porte.
On ne me permit pas d’emporter ma poupée, seulement ma petite mallette de couture où j’avais mis deux petits baigneurs, un blanc et un noir, ainsi qu’un canevas. Maman avait un sac où elle avait mis nos « quatre heures » et d’où dépassaient ostensiblement des aiguilles à tricoter. Nous allions passer l’après-midi à la campagne.
Le bombardement commença vers seize heures. Un oncle qui avait fait la grande guerre nous fit mettre en rang contre un haut talus. À chaque obus, il citait un chiffre, souvent le même : 75. Très vite, notre groupe avait grossi ; des voisins que l’on connaissait, d’autres, inconnus. Un garçon plus âgé que moi qui ne tenait pas en place revint tout à coup en criant : « Bressuire brûle, Bressuire est en feu ». Les hommes partirent aussitôt vers le haut des bois Luton. D’après eux, le quartier de Saint-Jacques n’était pas touché. Le bombardement cessa à la nuit tombante. Il fut décidé, à l’unanimité de ne pas rentrer chez nous et de rester coucher dans le foin.
Au petit jour, tous reprirent la route pour rentrer, sans savoir ce qui les attendait. Arrivés à la hauteur de la Léonière, un bruit de moteur nous figea sur place. C’était un side-car qui venait vers nous. Des Français ou des Allemands ? Papa ne savait pas. Il nous dit de continuer à marcher. Lorsque le véhicule passa près de nous, nous avons tous pensé, sans le dire, que c’étaient des Allemands. Nous sommes rentrés chez nous, sans faire de bruit, presque honteux.
Dans la matinée, un convoi allemand s’arrêta un moment dans le quartier. Papa nous avait interdit d’ouvrir les volets au rez-de-chaussée, mais au premier étage, nous avions des persiennes à travers lesquelles nous avons vu des soldats bien différents de ceux de la veille : jeunes, beaux, propres, gais, parlant fort, c’étaient des vainqueurs.
« Ce n’est pas tout, dit papa, aujourd’hui c’est dimanche, il faut aller à la messe ». Maman fit quelques observations : Est-ce que c’était prudent ? Papa répondit qu’il fallait continuer à vivre le plus naturellement, et que ce n’était pas les Allemands qui allaient l’empêcher d’aller à la messe.
Les rues étaient désertes ou presque, sauf quelques personnes qui se dirigeaient vers l’église et qui se saluaient, l’air triste. Je fus donc très étonnée de voir la grande nef remplie de fidèles. Je fus bousculée par les grandes personnes, et bien que ne voyant pas grand chose, il me sembla qu’il régnait un grande lumière bien inhabituelle. Les gens gémissaient sourdement. De plus, il y avait une sorte de crissement, comme lorsque l’on marche sur du sucre en poudre. Enfin, je pus voir que les gens, avant de s’asseoir dans les bancs, le long du mur, nettoyaient les sièges et faisaient tomber… du verre. C’est alors. que je constatai que dans la grande nef il n ‘y avait plus de vitraux, ces vitraux, on marchait dessus. Arrivée au transept, je vis les grands vitraux mutilés, et je compris alors pourquoi les gens gémissaient en voyant le désastre.
La première partie de la messe se déroula dans une grande ferveur. Quand brusquement, un bruit épouvantable sema la panique dans la foule des fidèles. Tout le monde se précipita vers les portes en criant de peur, les mères rappelaient leurs enfants qui étaient dans les chœurs latéraux. Les religieuses qui surveillaient les filles nous interdisaient de partir. La rumeur courut que les Allemands voulaient nous enfermer dans l’église pour y mettre le feu car de la fumée sortait de la sacristie. Enfin, un prêtre monta dans la grande chaire pour mieux se faire entendre, rétablir l’ordre et expliquer que c’était une pierre du clocher, ébranlée la veille par un obus qui venait de tomber sur la sacristie. La fumée n’était que de la poussière.
Malheureusement, le bombardement avait fait d’autres victimes que les vitraux : une dame qui fermait ses volets, rue Rouge, et un groupe de réfugiés des Ardennes qui s’étaient mis à l’abri, croyaient-ils, dans les caves de l’école des filles, rue de Versailles (Rue Héry) et d’autres, peut-être. Les maisons brûlées route de Thouars, les flaques de sang place Labâte, des casques français, des bérets souillés de sang m’impressionnèrent beaucoup.
Le lundi 24 juin, Le chanoine Charrier, notre curé, réunit ses séminaristes et leur demanda de ramasser avec beaucoup de soin les morceaux de vitraux tombés. On remarqua alors que les visages des personnages principaux étaient intacts. Nos grands vitraux furent déposés peu après et remplacés momentanément par d’immenses rideaux, puis par du verre transparent. Ce ne fut qu’en 1947 que les paroissiens purent admirer de nouveau leur « catéchisme en images » dont ils étaient si fiers. Les réparations avaient été faites avec tant de maîtrise, qu’il fut difficile de distinguer les minces filets de plomb qui réunissent les parties qui étaient brisées. Je crois savoir que l’artiste qui réalisa cette restauration est le Maître Verrier Louis Gouffault d’Orléans.
Souvent, l’été, des touristes visitent l’église et admirent (quelquefois bruyamment) nos magnifiques vitraux. Ils n’ont pas l’ancienneté de ceux de certaines églises, puisqu’ils datent du 19è siècle, mais qu’importe, ils ont survécu à la tourmente, et depuis le nettoyage qui a été fait il y a deux ou trois ans, ils sont plus beaux que jamais. »
Madeleine FROUIN
Décembre 2003