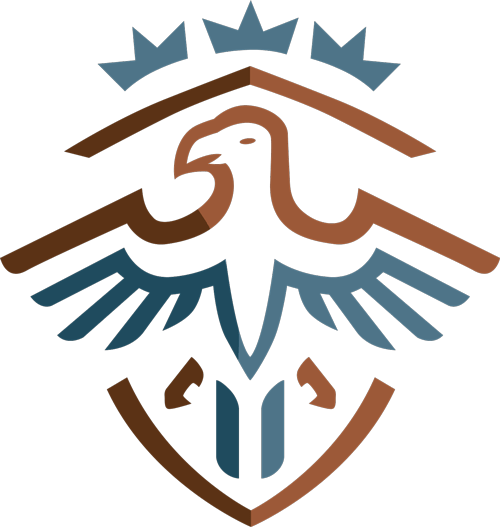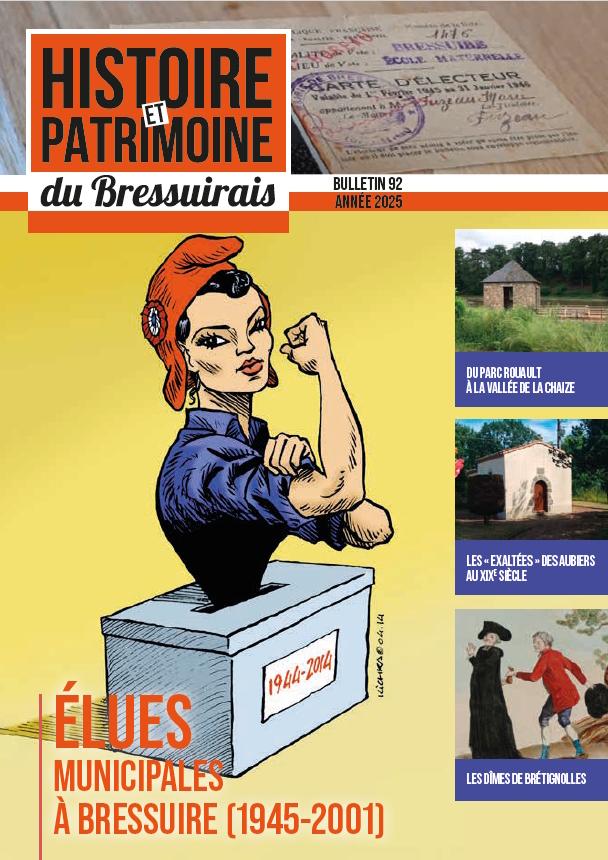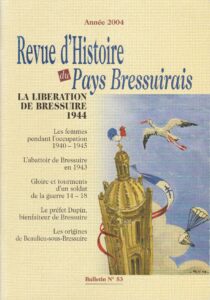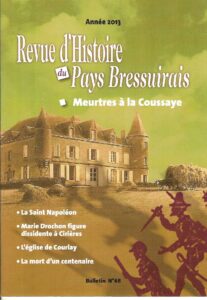Il y a 80 ans, la Seconde Guerre mondiale s’achevait. Après les humiliations, les destructions, il était urgent de reconstruire le pays sur de nouvelles bases. Le scrutin, enfin devenu universel avec le vote des femmes, fut un de ces moments historiques fondateurs même si, à l’époque, cette nouveauté de la vie civique est passée presque inaperçue. La journaliste Françoise Giroud dira plus tard : « on sortait d’un tel choc que c’est passé sur le moment pour un événement secondaire ».
Aujourd’hui, la plupart d’entre nous avons oublié la somme des luttes que les femmes ont menée depuis la Révolution française pour en arriver là, puis obtenir l’égalité femme-homme, au moins dans la loi. Bien peu serait capable de citer les noms de celles qui, chacune dans leur domaine, ont marqué cette longue histoire de combats, souvent héroïques, parfois dramatiques.
Parvenus à la fin de ce premier quart du XXIe siècle, nous ne pouvons qu’être alertés par les tentatives de reculs ici où là, de remise en cause de cette égalité pourtant chèrement acquise. Il nous appartient, à nous passionnés d’Histoire, de veiller à transmettre ce passé d’une France et d’un monde qui ont si longtemps considéré ‑ et parfois encore ‑ la moitié de l’humanité comme inférieure. Il est de notre responsabilité de rappeler les luttes de ces femmes, ponctuées de succès pour qu’enfin, un jour, cette égalité apparaisse naturelle.
Dans son article, « Elues municipales à Bressuire (1945-2001) », Dominique Lenne s’inscrit dans la continuité de ce mouvement de recherches sur les combats des femmes pour investir la vie politique. Après en avoir rappelé les principales étapes, elle s’est intéressée plus particulièrement à la place des Bressuiraises dans les conseils municipaux de Bressuire et de ses communes associées puis déléguées, de 1945 à 2001. Tout en montrant les difficultés pour les femmes de s’affirmer dans le contexte d’une petite cité encore rurale, elle distingue trois périodes qui correspondent aux mandats des trois maires qui se sont succédé à la tête de la municipalité au cours de cette deuxième moitié du XXe siècle.
Dans un tout ordre d’idée, avec son article « Du parc Rouault à la vallée de la Chaize », Roger Grassin s’est penché sur la destinée d’un site, celui de la Chaize, que tous les Bressuirais connaissent pour s’y être promenés à la belle saison. Tout le mérite de l’article est de nous remémorer qu’il a d’abord été un parc d’agrément privé pour une famille bourgeoise à la fin du XIXe siècle avant d’être abandonné pour devenir un lac, réserve d’eau et site de pêche à la ligne, aujourd’hui métamorphosé en zone naturelle de promenade.
Poursuivant ses recherches sur la Petite Eglise du Poitou, Pascal Hérault aborde une nouvelle fois la place occupée par les femmes au service des curés dissidents, à travers « Les « exaltées » des Aubiers. Des femmes au service des curés dissidents dans la première moitié du XIXe siècle ». Il montre avec beaucoup de justesse que l’Eglise dissidente doit beaucoup à ces femmes qui soutiennent leur curé menacé d’arrestation, s’opposent fermement au prêtre concordataire, assurent l’instruction des enfants. En retour, l’Eglise de Rome s’emploie à les discréditer, afin d’affaiblir la Petite Eglise.
De son côté, avec « De temps immémorial ». Le mémoire des dîmes de Brétignolles (1771-1791), Louis Guilloteau s’attache à étudier un document précieux par sa rareté et par son intérêt : le registre décimal du curé Hilaire, de Brétignolles, daté de la fin du XVIIIe siècle. C’est donc de la dîme dont il est question dans cet article, cet impôt ecclésiastique si impopulaire qu’il fut supprimé dès la Nuit du 4 août 1789, au début de la Révolution. A travers ce registre, l’auteur analyse comment cet impôt est perçu dans une petite communauté rurale proche de Bressuire, ce qu’il nous apprend des rapports entre les habitants, leur curé, ce qu’il nous dit des subsistances trop souvent insuffisantes.
Bonne lecture à tous.